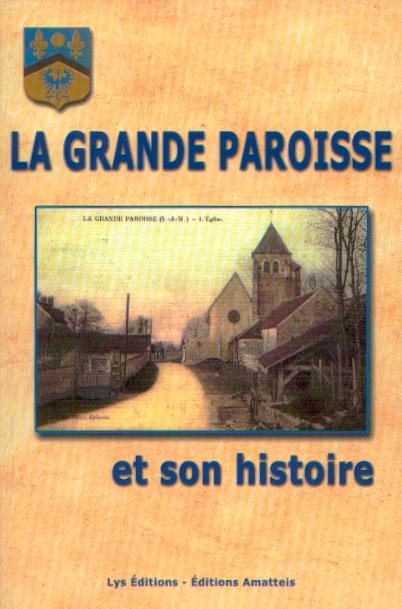La vallée de la Seine a été pour les hommes depuis les temps les plus reculés un lieu de passage et de séjour. Les restes d'un campement de plein air ont été découverts en 1964 sur le site de Pincevent . C'est A. Leroi-Gourhan, professeur au Collège de France, qui se chargea alors d'organiser les fouilles : elles allaient se révéler particulièrement fructueuses...
 pour plus de
détails, connaître l'histoire du site, cliquez sur le chasseur
pour plus de
détails, connaître l'histoire du site, cliquez sur le chasseurreproduction d'une poterie Type Cerny trouvée à Pincevent, cliquez pour voir l'original
Ce site a été visité et occupé pendant plusieurs siècles dès12000 avant JC . Les premiers chasseurs du Paléolithique supérieur venaient y chasser le mammouth, tandis que les derniers, les Magdaléniens, y avaient établi un campement et poursuivaient le renne. C'est ce campement qui a fait l'objet d'une fouille approfondie. Vers 8000 ans avant notre ère, les chasseurs de rennes trouvèrent probablement à Pincevent deux raisons qui les arrêtèrent : un gué sur la Seine et un gîte de silex sur les berges. L'étude des restes des ossements de rennes abattus, notamment la denture, conduit à penser que les magdaléniens séjournaient là de mai, environ, à novembre. Grâce à une technique très méticuleuse de décapage du sol couche par couche pour la première fois mise au point à Pincevent et qui fera ensuite école, le Professeur A. Leroi-Gourhan avec son équipe arrivera à reconstituer presque dans le détail les gestes quotidiens de ces hommes et de ces femmes confrontés à un climat beaucoup plus rude que l'actuel. Grâce à l'impulsion donnée par A. Leroi-Gourhan , pendant plus de 20 ans des équipes de chercheurs de plus de 50 nationalités se retrouveront (dans des conditions précaires...!!) sur le site de Pincevent aujourd'hui mondialement connu. Malheureusement, en dehors de ce site protégé, les importantes extractions de sable effectuées tout autour dans la vallée de la Seine depuis plus de 40 ans ont à jamais, en bouleversant les sols, effacé la mémoire de ces lieux.
Une très bonne nouvelle obtenue en 2007 : Pincevent accueillera le Centre de Conservation et d'Etude de l'Archéologie d'Ile-de-France. A l'initiative du conseil général de Seine & Marne une étude sur la valorisation du site archéologique vise à sa réouverture au grand public. Pincevent qui avait trop longtemps été délaissé et négligé va donc concourir au rayonnement culturel et au développement touristique local voire même régional.
Pour en savoir plus, cliquez sur la tente :

La reconstitution d'une tente des chasseurs de rennes de Pincevent
De la période Gauloise, aucune trace ne subsiste. Après la conquête de la Gaule par Jules César, un riche propriétaire Romain (peut-être un soldat récompensé pour sa bravoure ?) s'installa justement à Pincevent et y bâtit une grande villa. La villa romaine est essentiellement un gros centre de production agricole avec de nombreuses dépendances, la partie la plus confortable de la maison étant réservée aux propriétaires. Sur tout le territoire de la commune, à Pincevent mais aussi dans les sablières du mont de Rubrette, de nombreux témoignages de cette période ont été découverts (vase, clés et un rasoir, objets en bronze et monnaie romaine de Nîme...) Pendant cette période de paix qui s'étale sur plusieurs siècles, les villages et les villas"ouverts" sur l'extérieur, vont toujours se trouver près d'une source (source du lavoir de la rue Sainte Assise, près de l'église), sur des voies de passages avec si possible des terres légères plus faciles à cultiver : elles seront donc préférentiellement dans la vallée de la Seine. L'église de la Grande Paroisse, elle même du XIe siècle, est ainsi probablement installée sur un ancien habitat romain. Cependant, le village est lui beaucoup plus haut, en partie sur le coteau mais surtout sur le plateau. En effet les incursions puis les invasions de plus en plus massives des barbares qui mèneront à la disparition de l'empire romain, vont progressivement faire évoluer l'habitat. Indéfendable la vallée est peu à peu désertée au profit du plateau où pour des raisons de sécurité les villages se regrouperont. Pour mieux surveiller l'arrivée d'éventuels ennemis, les châteaux en bois fortifiés des Francs seront désormais sur les hauteurs des collines. Cependant certains des habitats romains (Tavers) sont toujours occupés par de riches seigneurs mérovingiens ou par des dignitaires religieux qui ont autant sinon plus de puissance que les chefs séculiers.
Et c'est ainsi que Childebert 1er, fils de Clovis, venait parfois se reposer à Tavers, hameau de la Grande Paroisse, au pied de la colline qui domine la rive droite de la seine. Au retour d'une expédition victorieuse menée en Bourgogne, il y séjourna et tomba gravement malade. En désespoir de cause, aucun remède n'étant efficace, il manda l'évêque de Paris, Saint-Germain. Renommé pour sa science et sa vertu, ce dernier, à force de prières et par imposition des mains réussit à le sauver de la mort.
Pour le remercier, Childebert 1er lui donna en janvier 531 Celles (la Grande Paroisse) ainsi que tous les domaines environnants. L'église de la Grande Paroisse lui sera dédiée.
 Eglise de la
Grande Paroisse début XXe
Eglise de la
Grande Paroisse début XXe
Pour découvrir le lavoir et
l'église en 2003 cliquez sur la photo ci-dessus.
La Grande Paroisse et tout son territoire (Vernou, Machault, Marangis, ...) furent donc administrés dès le VIe siècle par le Chapitre de Notre-Dame de Paris. Ce territoire nettement plus étendu que la commune actuelle est d'abord désigné par le nom latin chrétien de Cella qui signifie hermitage ou "petit monastère". Ce nom évoluera ensuite au cours des siècles avec semble-t-il des difficultés pour se fixer définitivement : "Magna Parrochia", "Selles", "Grant Paroisse" en 1527 redevenu "Selles en la Grande Paroisse" pour devenir enfin "La Grande Paroisse en Brie" au XVIIe siècle. Au VIIe siècle les défrichements, le développement de l'agriculture, la création de nombreux petits monastères marquent le rayonnement de la période Carolingienne. Un témoignage de cette période est conservé dans l'église de la Grande Paroisse sous la forme d'un sarcophage en pierre gravé d'arêtes de poisson et couvert d'une dalle en morceaux, daté du VIIe siècle. Il fut retrouvé au lieu dit "la Montage Baignière" et classé par les monuments historiques par arrêté du 27 octobre 1955. A la fin du IXe siècle, les invasions Normandes amorcent le début d'une longue période de désordre et de déclin. Mais aux XIe et surtout XIIe siècles les défrichements reprennent massivement sous la houlette des ordres religieux qui exploitent les fiefs du chapitre de Notre-Dame de Paris. C'est à cette époque que l'Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem installe la maladrerie de Champigny pour les lépreux revenus des croisades.
Situé essentiellement sur le plateau et s'étirant vers le hameau de "la Roche" mais comprenant également la pente descendant vers l'église, un ensemble plus important de maisons se constitua peu à peu et devint le hameau de Rubrette, seigneurie du Chapitre de Paris, puis village de la Grande Paroisse. Les archives nationales parlent à l'époque du Château de Rubrette qui a totalement disparu aujourd'hui.
Pendant tout le moyen age et jusqu'à la fin du XVIe siècle le système féodal s'appliqua et la seigneurie de la Grande Paroisse exerça pleinement ses droits de haute et de basse justice. L'administration du Chapitre de Notre-Dame de Paris sur la Grande Paroisse était sous la responsabilité de la Prévôté installée à Vernou. Institués par les chanoines, les sergents ou "servients" qui avaient charge de garder les prisonniers, de lever les amendes, d'arrêter les malfaiteurs et de rendre la justice, étaient logés à la maison seigneuriale. Cette maison devenue une belle maison d'habitation existe toujours : elle est maintenant connue sous le nom de "maison des Messieurs". Dépossédée en partie de ses terres en 1596 par Charles IX, l'église récupéra ses biens en 1678 et les garda jusqu'à la Révolution en 1791.
Un monument symbolise parfaitement à lui seul la période de l'Ancien régime sur le territoire de la Grande Paroisse : il se trouve au lieu dit "la Colonne" en bordure de la D606 (Ex RN6) reliant Montereau à Moret-sur-Loing. L’ obélisque de la Reine appelé aussi « la Colonne » commémore le lieu d’une entrevue royale : le 4 septembre 1725 Marie Leczinska, fille du roi Stanislas 1er et future Reine de France, rencontre Louis XV pour la première fois. Cette colonne en marbre rouge, érigée en 1739, repose sur un piédestal de style renaissance à 4 pans moulurés et recouverts d'une inscription latine dont la traduction en français est gravée en 1932. Le fût est surmonté d'un chapiteau et d'une boule de marbre blanc. Les trous de scellement des fleurs de lis et de la couronne royale supprimées lors de la Révolution sont encore visibles. Sa destruction totale fut d'ailleurs envisagée lors d'une délibération de citoyens de la commune de Moret sur Loing. Cependant étant située sur la commune de la grande Paroisse, elle réchappa finalement à ce sort funeste ...! Cette colonne, propriété de l’Etat, est inscrite aux monuments historiques et protégée par décret depuis le 15 février 1926. Auparavant située au centre du carrefour, elle fut déplacée sur le côté au moment de l'élargissement de la route nationale. Elle a été conçue par l’Architecte Boffrand Gabriel-Germain (1667-1754). Ce dernier, neveu du poète Quinault et élève de l'architecte François Mansart, travaille tout d'abord en Lorraine où, à la demande de Léopold de Lorraine, il réalise le château de Lunéville et la Malgrange à Nancy, restée inachevée. Par la suite, il s'installe à Paris où il projette et décore des palais aristocratiques notamment l’hôtel Amelot de Gournay en 1695. Son style architectural, influencé par un classicisme austère évolue vers plus d’exubérance et se retrouve jusque dans ses créations aux styles Régence et rococo, comme par exemple la décoration rocaille du salon ovale de l'hôtel de Soubise (1735). Il fut le plus fécond des créateurs de style Régence de Louis XV. Cependant en tant que "Premier Ingénieur des Ponts et Chaussées du Roi" il participa aussi aux reconstructions de plusieurs ponts importants de la région : le vieux pont de Charenton (1719-1863), le pont de Bray-sur-Seine (1730), le pont de Villeneuve-sur-Yonne (1735-1848), le pont de Pont-sur-Yonne (1735).
Pour voir d'autres photos de l'Obélisque cliquez ici
Cet Obélisque figure sur la Carte dite de "CASSINI" (elle fut réalisée par la famille Cassini) : cette carte fut relevée en 1752 par Joulain et elle fut publiée en 1757.
Le 1er Maire de la Grande Paroisse, le Conventionnel François Pierre Mauduyt, vota "pour la mort" de LOUIS XVI.
Fresque murale (Montereau) - armée de Napoléon Bonaparte
Les guerres Napoléoniennes s'illustrèrent sur le territoire de la commune en 1814 pendant la campagne de France. Toute la région de Montereau devient le théâtre, pendant le mois de février 1814, d'un combat acharné entre les troupes de Napoléon venant de Nangis et les troupes Autrichiennes et Wurtembergeoises, commandées par le Prince royal de Wurtemberg, Schwarzenberg, Ce dernier s'est installé dans le parc d'un château situé sur le plateau boisé de Surville qui surplombait la ville de Montereau située près du confluent de l'Yonne et de la Seine plus en contrebas. Malgré cette position très favorable, ses 15200 fantassins, ses 2700 cavaliers et ses 44 canons, les troupes alliées qui avaient occupé et pillé auparavant la ville de Montereau doivent battre en retraite. Elles détruiront les ponts pour éviter une déroute totale. Cette victoire, avec "seulement" 2500 victimes du côté français contre 6000 du côté autrichien, sera l'une des toutes dernières de Napoléon 1er avant sa chute finale. Pour en savoir plus sur la bataille de Montereau, consultez l'article consacré à la bataille de Montereau de l'encyclopédie Wikipedia.
Pour en revenir à la petite histoire, Claude Elie Montain Horeau, médecin de l'impératrice Joséphine et de l'empereur Napoléon 1er, membre de l'Académie de médecine, chevalier de la légion d'honneur, décédé le 11 février 1841, repose au cimetière de la Grande Paroisse... On peut encore voir son tombeau entouré d'une grille.


La ferme de Rubrette début XXe Les moulins de la Basse Roche début XXe
"La grande Paroisse et son histoire"
Les exploitations étaient minuscules, chaque famille vivant très modestement plus ou moins en autarcie, avec une ou deux vaches, un âne, parfois un cheval ou deux. Les paysans faisaient moudre leurs grains aux meuniers de la vallée des moulins. Toutes les maisons ou presque possèdaient un four à pain.
La commune était dans la première moitié du XIXe siècle essentiellement tournée vers la production de vins de médiocre qualité qui partaient en grande partie vers la capitale. On comptait en 1870 pas moins de 300 hectares de vignes étagées, bien exposées, tout le long des coteaux calcaires entre Montereau et Vernou. La production locale, la "pisserotte", si elle n'était certainement pas la plus mauvaise parmi toutes celles des environs, n'était pas quand même pas bien fameuse...Aussi, l'arrivée par la toute nouvelle ligne de chemin de fer Paris Lyon-Marseille des vins de Bourgogne et du sud de la France de bien meilleure qualité et à meilleurs prix provoqua dès 1860 une régression du vignoble briard. Le coup de grâce fut donné par le phylloxéra, puceron qui parasite les pieds de vigne, venu des Etats Unis : il apparut sur la commune en 1888. Le fléau fut enrayé grace à l'introduction de cépages plus résistants mais le déclin persista et en 1913 on ne comptait plus que 2 viticulteurs, un négociant en vin et 2 tonneliers sur la commune.
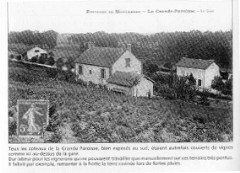
Les viticulteurs ont dû se reconvertir dans les céréales, l'élevage mais aussi dans le commerce, le petit artisanat ou bien sont devenus ouvriers et sont partis travailler à Montereau . La guerre de 1870 toucha la sommune mais c'est surtout celle de 14-18 qui fit payer un lourd tribut à la Grande Paroisse avec 53 morts ainsi que de très nombreux blessés et invalides.
La réduction du nombre d'exploitants commencée, commencée au début du XXème siècle, s'intensifia entre les deux guerres. Si la guerre 39-45 appauvrit la commune et fit des victimes, elles furent beaucoup moins nombreuses que lors de la "Grande guerre". La paix revenue, l'aspect de la commune se transforma très prondément à partir des années 1950. On peut signaler le remembrement qui imposa une redistribution et une rationalisation des terres agricoles, la disparition définitive des derniers carrés de vignes, la quasi disparition des prairies. Comme partout en France, l'intensification du travail agricole et le développement rapide de la mécanisation (disparition des chevaux de traits et de labour au profit des tracteurs) imposèrent une diminution du nombre des agriculteurs et une concentration des terres cultivables entre les mains de quelques fermiers. Beaucoup de terres jugées difficiles à travailler et peu fertiles retournèrent aux friches et furent peu à peu reboisées ou bien s'urbanisèrent. Le développement des sablières dans les années 1960 transforma en fouilles les terres cultivables de la vallée. On vit apparaître la station de pompage des eaux de la ville de Paris, l'implantation de la centrale EDF,un accroissement de l'urbanisme sur le plateau... Le phénomène continua dans les années 1970 et 1980 : en 1999 il n'y avait plus que 7 exploitants agricoles contre 37 en 1932. Depuis 1999 il n'y a plus de production laitière sur la commune. Les productions actuelles se résument au blé, orge, colza, tournesol, protéagineux, parfois un peu de tabac. La betterave sucrière a disparu. Dominant dans les années 1970 et 1980, le maïs grain est depuis 2005 en forte décroissance, des étés de plus en plus secs et la difficulté d'irriguer en raison de la diminution du niveau des nappes phréatiques ne permettent plus de couvrir ses besoins en eau tout en restant rentable.
Si la Grande Paroisse est restée très rurale sur le plateau, de nombreuses industries se sont implantées depuis le début du XXe dans la vallée : en 1914 est mise en service une première centrale électrique construite le long du fleuve près de Montereau,puis il faut noter la création de la "Société Chimique de la Grande Paroisse" en 1919 destinée à la production d'azote et à la mise au point de la synthèse de l'ammoniaque (fabrication des engrais chimiques et industrie de l'armement).
Mais c'est en 1964 qu'entre en service la centrale thermique la plus puissante de France à l'époque. Cette centrale est installée à moitié sur la commune de Vernou et l'autre sur la commune de la Grande Paroisse. Ses capacités de production étaient constituées de quatre groupes totalisant 750000 kilowatts : 2 tranches de 125 MW situées sur la commune de la Grande Paroisse et 2 tranches de 250 MW sur la commune de Vernou. Les tranches de 125 MW ont été mises en service en 1959 et 1960, celles de 250 MW en 1964 et 1965.. Ces chaudières ont été adaptées tour à tour pour brûler du charbon, du fuel, du gaz naturel puis en raison de la hausse du prix du pétrole à nouveau du charbon (la consommation pouvait aller en période de pointe jusqu'à 6000 tonnes de charbon par jour!) Cependant durant les années 1980, avec l'arrivée du nucléaire et la part de plus en plus réduite des centrales "à flamme" en France, sa production se réduit notablement et à partir des années 1990 son arrêt est désormais envisagé...L'ouverture d'une toute nouvelle centrale nucléaire à Nogent annonce déjà la fin de cette unité puissante mais particulèrement polluante.
En 1985 les tranches de 125 MW sont arrêtées, celles de 250 MW le sont à leur tour en 1995 puis 2004. La centrale s'est donc arrêtée définitivement en 2004. La démolition de la dernière cheminée côté Vernou a été réalisée en 2004 (voir photos).
Les travaux de déconstruction du bloc usine ont débuté en septembre 2007. Le planning du chantier de déconstruction va s'étaler sur plus de 5 ans (info bulletin municipal oct 2007 n°39) :
-2007 : expertises préalables, préparation des chantiers.
-Septembre 2007 : dépose de l'alimentation fuel.
-mai 2008 : désamiantage préalable (6 mois à 1 an de travaux)
-Septembre 2008 : chantier de déconstruction (3 ans de travaux environ)
-2013 : dépollution des sols en vue d'un usage industriel (?)
Le trafic routier sera limité par valorisation sur place des déchets bétonnés propres (unité de concassage).
Aujourd'hui seule une poignée de techniciens et de gardiens veillent sur les anciennes structures de la centrale. L'usage à des fins "industriels" des terrains dégagés par la démolition n'est pas clairement précisé par la Mairie.
 La
puissante centrale thermique va totalement disparaître du paysage communal
La
puissante centrale thermique va totalement disparaître du paysage communal
Pour visualiser sa démolition cliquez sur la photo !
Juste à côté de cette centrale, nous retrouvons l'activité agricole avec le complexe céréalier du groupement coopératif IN VIVO (ex UNCAA). La capacité de stockage de ces silos est, avec plus de 1700000 quintaux, une des plus importante d'Europe. Le site appartenant au groupe "SIGMA" comprend également un laboratoire d'analyses et emploie une soixantaine de personnes.

Enfin pour compenser en partie les pertes d'emplois dues à l'arrêt de l'usine EDF, une zone industrielle de 4 hectares est créée route de Montereau. Depuis 1985, une dizaine d'entreprises s'y est installée. Elles employaient quelques 150 personnes en 1999.
En 2003, les habitants de la Grande Paroisse vont pour la plupart travailler en dehors du territoire de la commune : dans les villes voisines ( Montereau, Fontainebleau, Melun ou même jusqu'à Paris), dans le secteur secondaire mais surtout maintenant dans le tertiaire qui s'est considérablement développé ces dernières années. Certains ont vu dans cette diminution importante de l'activité sur le territoire communal une diminution dangereuse des taxes et donc des recettes communales. C'est dans ce contexte que des projets de cimenterie et de carrière ont commencé à circuler dès le milieu des années 1990.
Avec 2472 habitants en 2004, le double de sa population de 1837, la Grande Paroisse a cependant su conserver en grande partie son paysage rural. Ses habitants qui travaillent tous les jours dans un milieu essentiellement urbain ont besoin de retrouver autour d'eux cette ruralité le soir, le week-end ou pendant les vacances. Dans une île de France qui subit depuis des années un urbanisme galopant, il est urgent de prendre des mesures pour préserver une fois pour toute ce paysage des agressions industrielles, ne pas céder aux pressions mercantiles et éviter de défigurer définitivement ce patrimoine qui nous a été légué intact à travers des générations de paysans.
Vous trouverez ici en détail toutes les statistiques récentes publiées sur la Grande Paroisse
Depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant , une communauté EMMAÜS s'est installée dans une ancienne ferme à Rubrette . Les compagnons de l'abbé Pierre accueillent des personnes en difficulté, d'anciens SDF, et les aident à retrouver une activité, à reprendre confiance en eux en leur confiant peu à peu de nouvelles responsabilités au sein même de la communauté ou bien en dehors. Pour en savoir plus consultez la vidéo sur la communauté Emmaüs de la grande Paroisse.
Pour voir un paysage encore bucolique un peu à l'écart des routes à la frontière des communes de la grande Paroisse et de Vernou : la vallée des moulins, il est préférable de monter à cheval....cliquez sur l'image ci-dessous...!

Une grande partie des informations a été tirée du remarquable et très documenté ouvrage "La Grande Paroisse et son histoire" de Mme G. Pasquier et Mme M. C. Soutan, 1ère édition en 1979 rééditée et réactualisée en 2000 Lys éditions - Editions Amattéis -
Où trouver ce livre : à la mairie de la Grande Paroisse (Prix : environ 15,25 Euros). Pour un achat en ligne.
REVUE SCIENTIFIQUE SPECIALISEE :
La Grande-Paroisse (Seine-et-Marne) : occupations protohistoriques en rive gauche de Seine
Auteurs : BULARD A. ; DEGROS J. ; DROUHOT C. ; TARRÊTE J.
Source : congrès sur l'habitat et l'occupation du sol à l'âge du Bronze en Europe. Colloque international (16/05/1990) 1992, no 4 (3 réf.), pp. 129-132. Pour un achat en ligne.